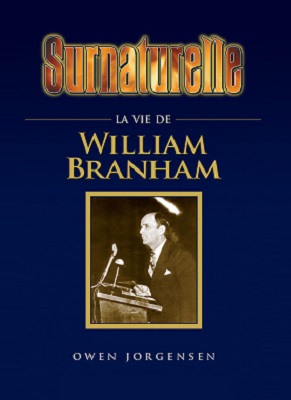
La Série Surnaturelle
La vie de William Marrion Branham
Owen Jorgensen
Battu sans pitié
Chapitre 4
1922-1923
Les expéditions en ville
déprimaient souvent Billy. La famille Branham avait mauvaise réputation dans
la région de Jeffersonville et, plus d’une fois, des gens avaient changé de
trottoir pour éviter Billy. Certaines personnes parlaient à Billy pour
autant qu’on ne les voie pas, mais, dès que quelqu’un approchait, la
personne qui parlait à Billy le quittait et s’éloignait. Ça faisait mal.
Billy savait que son père et ses oncles étaient des gens durs, fumant,
chiquant du tabac, jouant à l’argent, buvant et fabriquant illégalement de
l’alcool, mais Billy pensait amèrement « Qu’est-ce que j’ai fait? Je ne suis
pas coupable de cela. Je n’ai jamais bu de ma vie. Pourquoi est-ce à moi
qu’on fait payer cela? »
Ce n’est pas que Billy n’ait
jamais essayé de boire. Un dimanche matin de printemps, Billy et Edward
marchaient le long de la rivière avec leur père et M. Dornbush, le voisin
qui avait fait la soudure aux distilleries de Charles. Les deux garçons
envisageaient de prendre leur vieux canot qui prenait l’eau pour remonter et
descendre la rivière à la recherche de bouteilles de verre vides. Charles
avait toujours besoin de bouteilles pour sa bière maison et il les payait un
bon prix, cinq sous pour une douzaine. M. Dornbush aimait bien Billy, alors
Billy essayait de l’impressionner, espérant qu’il lui prêterait son canot
étanche pour la matinée. Le bateau de Billy n’avait pas de gouvernail, si
bien qu’il était difficile à manœuvrer quand il y avait beaucoup de courant.
En guise de rames, Billy devait utiliser deux vieilles planches ; il ramait
maladroitement d’un côté du bateau, tandis qu’Edward faisait de même de
l’autre bord.
Près de la rivière, un arbre était
couché en travers du sentier. Charles passa une jambe par-dessus l’arbre,
mais, au lieu de l’enjamber, il s’appuya contre une branche et dit : «
Arrêtons-nous ici un moment. » Sortant un petit flacon plat de whisky de sa
poche revolver, il en prit une gorgée puis le tendit à M. Dornbush. M.
Dornbush en prit aussi, puis le redonna à Charles qui le mit entre des
racines retournées.
Pour Billy, c’était un moment
comme un autre pour demander une faveur. « M. Dornbush, pensez-vous que mon
frère et moi pourrions emprunter votre canot pour la matinée? »
« Certainement, Billy. Il n’y a
pas de problème. »
Tout excité, Billy pensa : « Voilà
enfin quelqu’un qui m’aime bien. »
Charles reprit une lampée de
whisky et passa de nouveau le flacon à son ami. Lorsque celui-ci eut étanché
sa soif, il tendit la bouteille à Billy en disant : « Tiens Billy, prends-en
une gorgée. »
Billy dit : « Non merci, je ne
bois pas. »
M. Dornbush parut étonné. «
Veux-tu me dire que tu es un Irlandais et un Branham et que tu ne bois pas?
»
Charles acquiesça avec dédain,
disant : « J’élève huit garçons, mais il n’y a qu’une poule mouillée parmi
eux et c’est Bill. »
Billy s’emporta. « Moi, une poule
mouillée? » Il eut un mouvement de recul à cette idée. « J’en ai assez de me
faire traiter de poule mouillée. Passez-moi cette bouteille. » Billy
l’arracha des mains de l’homme, tira le bouchon et la porta à ses lèvres
avec une détermination féroce. Il allait commencer à boire, mais, avant même
qu’une seule goutte de whisky coule dans sa bouche, il entendit comme un
bruissement dans les feuilles,
whoossssh. Sa main s’arrêta, le
goulot encore aux lèvres.
Whoossssh. Ce n’était pas son imagination ; il l’entendait aussi clairement que la
conversation autour de lui.
Whoossssh. Sa mémoire lui rappela brusquement cette voix qu’il avait entendue dans le
peuplier, lui commandant «
Ne bois jamais, ne fume ni ne
souille ton corps d’aucune façon. Il y aura un travail à faire pour toi
quand tu seras plus âgé. » Terrifié, Billy laissa tomber
la bouteille par terre et partit en courant à travers champs, versant des
larmes amères de frustration et de confusion.
Charles ricana : « Tu vois, je te
l’avais bien dit ; celui-là est une poule mouillée. »
Quelle que fût la direction prise
par Billy, il se heurtait à la cruauté de la vie. Il poursuivit sa formation
scolaire jusqu’à la septième année. C’était comme gravir une colline avec
des béquilles. Le système scolaire rural exigeait que les élèves fournissent
eux-mêmes leurs livres et leur matériel scolaire. Les parents de Billy
n’avaient pas d’argent pour les crayons et le papier, sans compter les
livres. Alors, chaque fois que Billy devait étudier ses leçons, il devait
emprunter le livre d’un autre élève.
Le programme scolaire de l’époque
était conçu pour modeler autant le caractère moral de l’élève que son
intelligence. Une leçon toucha profondément Billy ; c’était une étude sur le
poème
L'Hymne à la vie de Longfellow.
Ne me dites pas encore
avec langueur,
De la vie qu’elle
n’est qu’un rêve vide!
Car l’âme qui
sommeille, déjà est éteinte,
Et aux apparences il
ne faut se fier.
La Vie est réelle! La
Vie est intense!
Et le tombeau n’est
pas son but ;
Tu es poussière et à
elle tu retourneras,
N’a pas été dite
concernant l’âme.
Ni les plaisirs, ni
les chagrins,
Sont de notre destinée
l’accomplissement ;
Mais d’agir pour que
chaque lendemain
Nous trouve plus loin
qu’aujourd’hui.
L’Art demeure, mais le
Temps fuit,
Et nos cœurs, quoique
braves et forts,
Battent tels les coups
assourdis d’un tambour
Une marche funèbre
vers la tombe.
Dans le vaste champ de
bataille,
Dans le bivouac de la
Vie,
Ne soyez pas comme du
bétail muet et conduit!
Soyez héros dans la
querelle!
Ne faites pas
confiance au Futur, même s’il est agréable!
Laissez le défunt
Passé enterrer ses morts!
Agissez, agissez dans
le Présent vivant!
Le cœur engagé et Dieu
qui veille!
La vie des grands
hommes nous rappelle
Que nous pouvons
rendre nos vies sublimes,
Et, partant, laisser
derrière nous
Des traces dans les
sables du temps ;
Empreintes que
peut-être un autre,
Naviguant sur le
solennel canal de la Vie,
Un frère triste et
naufragé,
En les voyant, prenne
courage à nouveau.
Montrons-nous donc à
la hauteur,
Le cœur prêt pour
chaque saison ;
Accomplissant,
poursuivant toujours,
Apprenant à travailler
et à attendre
Ce poème inspirait Billy. Même
dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait imaginer les profondes
empreintes que sa vie laisserait dans les sables du temps. Pour le moment,
le poème de Longfellow chantait une chanson d’espoir dans une terre aride.
Ces paroles élevées parlaient au cœur de Billy, encourageant cet adolescent
de quatorze ans désillusionné, qui luttait pour comprendre toutes les
injustices qu’il voyait dans sa vie. Les garçons plus âgés le harcelaient et
se moquaient de lui continuellement, parce qu’il venait du Kentucky, parce
qu’il était pauvre, parce qu’il était petit pour son âge, parce qu’il était
différent.
Maintenant, Billy comprenait la
raison pour laquelle sa famille était si pauvre ; son père avait un
problème, il buvait. Un jour que les enfants de l’école se moquaient de lui
parce qu’il était vêtu de haillons, Billy lut, dans un manuel d’histoire, un
épisode à propos d’Abraham Lincoln qui débarquait d’un bateau à la
Nouvelle-Orléans et qui passait par un marché d’esclaves. Selon le récit,
Abraham Lincoln vit un blanc qui faisait une offre pour acheter un grand
gaillard noir costaud, alors que la femme et les enfants de l’esclave se
tenaient à côté et sanglotaient. Lincoln frappa des mains et dit : « Ceci
est mal! Et un jour je ferai cesser cette chose, même si je dois y laisser
ma vie. » Billy remit le manuel d’histoire en place et pensa : « Boire,
c’est mal aussi! Et un jour je ferai cesser cela, même si j’y laisse
ma vie! »
Mais rien n’enflamma plus son
imagination que ce qu’il lut au sujet du désert d’Arizona, dans son livre de
géographie de première année. Il rêva d’y être, rêva d’aller à cheval et de
galoper dans ces grands espaces parsemés de cactus. Ça avait l’air si
romantique, si apaisant, tellement idyllique. Le poète en lui s’émouvait,
mais il n’avait rien sur quoi écrire ses pensées ; alors, il emprunta une
feuille de papier à son voisin et écrivit :
Je me languis, me languis tellement
de ce Sud-Ouest lointain,
Là où les ombres tombent
par-delà les crêtes des montagnes.
Je peux y voir un coyote dissimulé
dans le crépuscule bleuté ;
Je peux y entendre le cri de l’aigle,
qui surplombe les pâturages.
Et quelque part du haut d’un canyon,
je peux entendre du lion le gémissement,
Dans ces lointaines montagnes Catalina,
aux frontières de l’Arizona.
Malheureusement, le harcèlement
des garçons plus âgés allait plus loin que juste la moquerie. Après l’école,
ils se liguaient contre lui régulièrement. Même s’il était petit pour son
âge, Billy était courageux et avait assez de tempérament pour se battre
contre une scie mécanique. Les garçons le jetaient par terre et il se
relevait. Ils le frappaient donc jusqu’à ce qu’il n’ait plus la force de se
relever. Plusieurs fois, il dut aspirer son souper avec une paille, parce
que sa bouche était trop meurtrie pour manger de la nourriture solide.
Un jour de printemps 1923, Billy
raccompagna une fille de l’école chez elle en portant ses livres. Sur le
chemin de retour à la cabane, cinq costauds l’attendaient. Ils l’envoyèrent
dans la poussière. L’un d’eux ricana : « Pourquoi est-ce que tu vas avec
cette fille? » Un autre se moqua : « Ouais, nous ne voulons pas que tu
ailles avec elle, sale petit sauvage du Kentucky. » Ils savaient que Billy
était né au Kentucky et que sa mère était à demi indienne, ce qui faisait
d’elle une squaw, alors, ils le raillaient en l’appelant le sauvage du
Kentucky.
À cette insulte, Billy sauta sur
ses pieds et fonça sur eux, les poings battant l’air. Mais cinq contre un,
c’était trop pour lui. Les brutes luttèrent corps à corps avec lui jusqu’à
lui immobiliser les bras. Puis, alors qu’il était sans défense, un garçon
prit une pierre et frappa Billy au visage jusqu’à ce qu’il s’affaisse,
presque inconscient.
Billy les supplia : « Si vous me
laissez partir, j’irai directement à la maison, je le promets. »
Et comme il était, de toute
manière, presque inconscient, ils acquiescèrent. Mais ils le jetèrent
d’abord par terre, lui plaquèrent le visage contre le sol puis lui donnèrent
des coups de pieds, comme touche finale de leur acte de méchanceté, avant de
s’en aller.
Billy s’en alla bien directement à
la maison, mais pas pour y rester. Il prit sa carabine Winchester de calibre
.22 qui était accrochée au-dessus de la porte de la cabane, la chargea de
seize balles, puis emprunta un raccourci à travers un fourré pour gagner un
endroit de la route où il savait que les cinq garçons passeraient. Il se
cacha près de la route et attendit. Bientôt, il entendit des voix.
« Cela apprendra à ce “mangeur de
maïs” d’aller avec une fille », disait l’un d’eux. Un autre reprit : «
Avez-vous remarqué comme il avait l’air effrayé? » Un autre se moqua : «
Ouais, ce sauvage du Kentucky apprendra à se tenir dorénavant. »
Sortant de derrière les fourrés,
Billy leur barra la route, son fusil, armé, pointé sur eux. Il dit calmement
: « Lequel d’entre vous veut mourir le premier afin de ne pas voir les
autres mourir? » Les cinq garçons pâlirent et se mirent à pousser des cris
de terreur et d’incrédulité. Billy dit : « Arrêtez de brailler parce que
vous allez tous mourir, l’un après l’autre » et il pointa son fusil sur
celui qui l’avait frappé avec la pierre : « en commençant par toi. »
Il pressa la gâchette.
Clic. Le coup ne partit pas. Rapidement, Billy chargea de nouveau, enfonçant
une nouvelle balle dans la chambre. Clic, le coup rata de nouveau. Pendant
ce temps, les cinq garçons courraient, criant, sautant par-dessus les fossés
et contournant les arbres, faisant tout ce qu’ils pouvaient pour s’en aller
de là le plus vite possible. Billy, bien décidé à les tuer, continuait à
charger son arme et à presser la détente le plus rapidement qu’il pouvait.
Clic, clic, clic, clic... Mais toutes les balles firent long feu.
Les cinq garçons étaient partis
depuis longtemps. Les seize balles de Billy étaient éparpillées sur le sol.
Il les ramassa, souffla la poussière qui les recouvrait, puis les remit dans
le fusil. Il visa alors un arbre et pressa la détente : crac, crac, crac,
crac... Cette fois-ci, tous les coups partirent, claquant en touchant le
tronc, faisant voler des morceaux d’écorce dans toutes les directions. Billy
se tenait au milieu de la route, bouillonnant de colère. Puis il se mit
soudain à rire, un rire dur, dément, qui s’échappait des profondeurs de sa
frustration. Il rit tellement que les larmes coulèrent sur ses joues
enflées.
Lorsque l’année scolaire fut
terminée, Billy quitta l’école et n’y revint plus jamais.
